
Urbain II prêchant la première croisade. Francesco Hayez (1791-1882)
Philippe Ier, soucieux de faire la paix avec l’Eglise, promit alors de se plier aux exigences matrimoniales du pontife (de façon éphémère…) et souscrivit à son appel pour la Terre Sainte. Tous les croisés et leurs biens étaient placés sous sa protection.
En revanche, ses tentatives de rapprochement avec Byzance pour restaurer l’unité de l’Eglise restées vaines s’aggravèrent et, par la suite, le schisme fut encore renforcé par les croisades.
Le 15 juillet 1099, Jérusalem était conquise au terme d’efforts épuisants et au prix d’atrocités. La victoire sur l’armée égyptienne à Ascalon (12 août) assurait provisoirement ce premier succès.
Mais Urbain II était mort le 29 juillet à Rome sans avoir connu cet évènement.
A sa disparition, certes de nombreux problèmes importants n’étaient pas réglés. Mais la papauté et l’Eglise romaine avaient raffermi leur autorité fortifiée dans les principes grégoriens.
Urbain II aurait dû être inhumé en la basilique Saint-Jean-de-Latran où l’avaient précédé d’autres pontifes. Durant une bonne partie de son pontificat, Rome avait été aux mains des partisans de Clément III.
Urbain II n’avait parachevé la reconquête de la ville qu’en 1098. Toutefois, il semble que pour des raisons de sécurité on ait préféré la crypte vaticane pour sa tombe sur laquelle on raconte que des miracles se produisirent bientôt.
Malgré ce culte et son inscription dans plusieurs Martyrologues, sa fête n’a jamais été reconnue par l’Eglise universelle qui se contenta de le béatifier en 1881.
Sa sépulture fut l’une des premières à disparaître lors des travaux de la nouvelle basilique au 16ème siècle. Si restes il y avait, furent-ils placés avec d’autres ossements dans un coffre commun ? C’est fort probable, mais depuis…
URBAIN II (Eudes de Châtillon ou Odon de Lagery) (v. 1035 – 29 juillet 1099)
13 avril 2014
Devant affronter un empereur germanique entravé dans sa souveraineté et l’antipape Clément III (Guibert) qui gouvernait Rome avec ses partisans, la situation était très complexe.
Tout en en confirmant la législation de Grégoire VII contre le nicolaïsme, la simonie et l’investiture laïque, il sut aussi se montrer conciliant et affermir sa position en remportant de nombreux succès dans plusieurs pays comme avec l’Angleterre, l’Espagne –il soutint avec succès la Reconquista des territoires occupées par les Maures-, ou la France où, pendant longtemps, il agit avec circonspection envers Philippe Ier qui avait répudié sa femme pour en épouser une autre.
Mais, en dehors des détails de sa politique, Urbain II reste surtout dans les mémoires pour être LE pape qui appela à la première croisade en 1095. C’est là qu’il apparut à la tête de chrétienté occidentale tant sur le plan spirituel que politique.
L’empereur Henri IV, excommunié à l’instar de Philippe Ier, se trouvant réduit à l’impuissance dans un coin d’Italie, Urbain II profita de son avantage provisoire. Le 27 septembre 1095, à Clermont (Clermont-Ferrand), il prêcha avec enthousiasme la première croisade, moyen d'unifier la chrétienté occidentale sous l'autorité pontificale. Sans en peser toutes les conséquences, il engageait ainsi tout le mouvement des croisades de l’histoire.
Chanoine puis archidiacre de Reims, grand prieur à Cluny, il fut transféré à Rome (1079/1080) à l’appel de Grégoire VII qui réclamait des moines. Créé cardinal-évêque d’Ostie, il entama son long bras de fer contre l’empereur germanique Henri IV et l’antipape Clément III désigné par l’empereur.
Le temps du bref règne de Victor III et Eudes devint pape sous le nom d’Urbain II.
Fidèle à la grande réforme de Grégoire VII, mais plus diplomate et habile, même à l’occasion sans scrupules, il admit des considérations de politique réaliste.
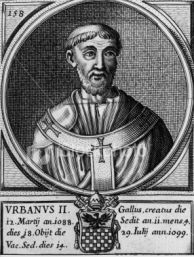
► 159ème pape ► 12 mars 1088 - 29 juillet 1099
► Successeur de Victor III
► Bienheureux

TOMBES SÉPULTURES DANS LES CIMETIÈRES ET AUTRES LIEUX
par Marie-Christine Pénin
| THEMES |
| DE A à Z |
Pour s'abonner à la Newsletter : CLIQUER sur "Contact" en précisant bien le sujet et votre adresse E.mail.
LIEUX D'INHUMATIONS
EN LIGNE
-Abbaye, couvent et séminaire St-Magloire (75) (disparus en partie)
(ancien cimetière révolutionnaire)
(ancien cimetière révolutionnaire)
-Cimetière St-Jean-en-Grève (75) (disparu)
(disparu)
Cimetière Ste-Catherine (75)
(disparu)
-Eglise St-Denis-de-la-Chartre (75) (disparue)
(disparue)
COPYRIGHT 2010 - 2024 - TOUS DROITS RÉSERVÉS - Ce site est propriétaire exclusif de sa structure, de son contenu textuel et des photos signées MCP. Sauf accord du propriétaire du site, toute reproduction, même partielle, à titre commercial est interdite. Les reproductions à titre privé sont soumises à l'autorisation du propriétaire du site. A défaut, le nom du site et de son auteur doivent obligatoirement être mentionnés. Tous les droits des auteurs des oeuvres protégées reproduites et communiquées sur ce site sont réservés.