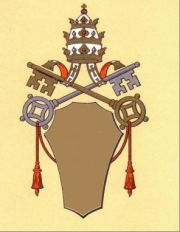


SÉPULTURES DES PAPES
© MCP

D’après l’Evangile selon saint Matthieu, Pierre fut désigné comme celui sur lequel l’Eglise repose. Lui et ses successeurs en sont les gardiens jusqu’à la fin des temps.
Toutefois, il fallut attendre le synode convoqué en 1081 pour que Grégoire VII se voit conférer le nom de pape qui devint alors le synonyme d’évêque universel.
A noter également que c’est après leur retour d’Avignon au 14ème siècle que les papes s’établissent définitivement au Vatican.
Hommes de guerre ou de paix, princes corrompus ou moines martyrs, si tous n’ont pas marqué les mémoires, si les décisions de certains ont entraîné une regrettable image de l’Eglise alors que d’autres l’ont grandie: la papauté a survécu et affiche deux mille ans d'histoire.
Bien qu’elle soit combattue de l’extérieur, contestée de l’intérieur parfois même engoncée dans le temporel jusqu’au scandale, la papauté ne vit jamais faiblir l’attachement de ses fidèles convaincus de la pérennité de la promesse faite par le Christ à Pierre. Et puis, comme l’a affirmé en termes lapidaires saint Amboise, évêque de Milan : « Là où est Pierre, là est l’Eglise ». Dont acte.
► La liste officielle
Selon la liste officielle, en 2009, avec Benoît XVI, 265 papes ont très officiellement chaussé les souliers de saint Pierre y compris lui-même.
En réalité, à cause d’une pincée d’antipapes qui apparaissent ou pas dans cette liste, de certains élus et déposés le jour même, de Benoît IX qui fut élu pape trois fois (trois pontificats d’enregistrer mais un seul homme), etc., le nombre de papes de la liste peut admettre une légère variante.
Au moins deux références incontournables ont permis d’établir la liste et la « biographie » des pontifes.
La première est due à saint Irénée, évêque de Lyon, qui fit l’inventaire exhaustif des papes de saint Pierre jusqu’à 189 date de la mort du pape Eleuthère, dont il fut le contemporain.
La seconde est le Liber Pontificalis qui, complété et enrichi avec les siècles, va jusqu’au 15ème siècle.
A cela il faut rajouter d’innombrables autres sources écrites et surtout les découvertes archéologiques grâce auxquelles la connaissance de la chrétienté des premiers siècles a fait un grand pas.
Néanmoins, des doutes subsistent quant à la véracité de faits de vie et de mort parmi les papes les plus anciens.
Reste encore un petit nombre d’entre eux sur lesquels aucun renseignement n’a jamais été trouvé.
► Les lieux de sépultures jusque l’an Mil
Dans l’ensemble on connaît bien l’emplacement des tombes des papes, du moins à partir du moment où l’Eglise de Rome a organisé la célébration de leur anniversaire auprès de leur sépulture, c’est à dire après le milieu du 3ème siècle. On nota alors dans les calendriers l’anniversaire des papes martyrs à partir de celui de Calixte († 222), et celui des papes non martyrs à partir de celui de Lucius († 254).
Malheureusement, à l’exception de saint Pierre, les textes manquent pour localiser les sépultures des papes des deux premiers siècles. Les auteurs du Liber Pontificalis, qui n’en savaient pas plus que nous, ont supposé qu’ils furent ensevelis auprès de saint Pierre dans la nécropole de la colline du Vatican.
Le premier de la liste dont on soit sûr de la tombe est Calixte puisqu’on l’a retrouvée; puis viennent les tombes des papes inhumés dans la catacombe de Calixte sur lesquelles aucun doute n’est possible.
Au 4ème siècle, avec le retour de « la paix de l’Eglise » succédant à la grande persécution de Dioclétien, on assiste à une nouvelle période de l’histoire des sépultures pontificales se caractérisant par la dispersion des tombes et l’émergence progressive de l’inhumation ad sanctos (près du corps des saints), sauf Damase qui, ne souhaitant pas les déranger, fit un autre choix.
Mais au 5ème siècle, les papes vont doucement se tourner vers une figure encore plus symbolique : saint Pierre, auprès de qui, sauf quatre exceptions, ils se firent tous ensevelirent de Gélase Ier († 496) à Anastase III († 913)
Avec le 10ème siècle et son lot d’exceptions, arrive une nouvelle période de dispersion des tombeaux avec des papes qui choisissent de se faire enterrer, comme les autres évêques, dans leur cathédrale ou dans la principale église de la cité.
► Les lieux de sépultures du 11ème au 15ème siècle.
Durant cette période, seuls neuf papes ne furent pas inhumés en Italie, mais en :
-Allemagne
►Benoît V
Cathédrale de Hambourg, puis transfert à Rome dans un lieu inconnu
►Clément II
Cathédrale de Bamberg (Allemagne)
-Crimée (Ukraine ou Russie...)
►Martin Ier
Cherson en Crimée
-Espagne
►Benoît XIII
Château d'Illueca (Espagne)
- France
►Gélase II
Abbaye de Cluny (Saône-et-Loire)
► La papauté en Avignon
On ne peut parler d’inhumation en France, sans évoquer la papauté en Avignon (1305-1378 et/ou 1378-1403)
L’agitation à Rome et la menace que faisaient peser sur les Etats pontificaux la politique impériale et l’appétit des puissances italiennes amenèrent les papes à préférer une résidence provisoire en dehors de Rome.
Le choix d’Avignon fut d’abord fortuit et imposé par les circonstances du conflit auquel la diplomatie pontificale tentait de mettre fin entre la France et l’Angleterre à propos de l’Aquitaine. ► Philippe IV.
En fait, depuis la chute de Saint-Jean d’Acre en 1291, la grande idée des pontifes était de reprendre les Croisades pour éviter le danger que représentait les Turcs sur l’empire d’Orient. Or, ce projet n’était réalisable que si la France et l’Angleterre cessaient les hostilités qui absorbaient leurs forces vives.
Offrant calme et sécurité, de surcroît position idéale pour gouverner la Chrétienté dont le centre était rejeté vers l’Ouest sous la poussée ottomane, Avignon était parfaite.
Avec le retour à Rome de Grégoire XI en 1377, les Romains firent pression sur le conclave pour que son successeur soit au moins italien. Ce fut l’élection d’Urbain VI contre laquelle s’éleva celle de Clément VII qui rentra à Avignon mais fut inhumé à Rome. C’est ainsi que la Chrétienté connut une période douloureuse, celle du Grand Schisme qui vit deux papes se disputer la légitimité de leur fonction.
Le temps passant, Avignon n’était dorénavant plus en mesure de justifier son privilège. Benoît XIII (Pedro de Luna) mit fin au règne pontifical de la ville en s’enfuyant incognito en 1403 sur les terres du comte du Provence en refusant toujours de renoncer à sa tiare. Il décéda à Péníscola en Espagne.
La tradition et la logique veulent que seuls soient retenus les papes ayant eut un pontificat légitimé. En conséquence, le nombre de papes en Avignon est normalement de sept. Toutefois, il est aussi fréquent de prendre en compte les pontificats de Clément VII et Benoît XIII.
Enfin, Grégoire XII (†1417) fut le dernier pape à être enseveli à l’extérieur de Rome.
A partir du décès de son successeur, Martin V († 1431) jusqu’à celui de Jean-Paul II († 2005) tous furent inhumés dans la capitale italienne et gageons qu’il en sera encore longtemps comme cela.
En presque deux mille ans de papauté qui à ce jour engendrèrent 264 sépultures, seule une petite poignée de papes, à la quelle on rajoutera Martin Ier inhumé en Ukraine, repose à l’extérieur des frontières italiennes.
C’est à Rome, ville éternelle à plus d’un titre, qu’ils choisirent d'être inhumés dans leur immense majorité.
► Les sépultures à Rome
Comme indiqué précédemment, les catacombes furent un haut lieu d’inhumations des papes. Bien que concentrées dans la basilique Saint-Pierre (142 inhumations répertoriées dont certaines, rappelons-le, le sont par simple supposition), on note aussi l’importance de la basilique Saint-Jean-de-Latran ainsi que quelques églises.
► Outre les premiers papes sur lesquels on ne peut qu'établir des hypothèses, on ignore les lieux d'inhumation de :
►Grégoire VI
►Jean XIX
►Romain
►Silvestre III
►Valentin
► Les cœurs et entrailles
Sous le pontificat de Sixte Quint, le palais du Quirinal devint la résidence pontificale et fut considérée comme telle jusqu’en 1870 où elle devint le palais de l’Italie unifiée.
A proximité, face à la fontaine de Trévi, en retrait de la petite place, se dresse la façade de l’église Saints Vincent et Anastase (S.S. Vincenzo e Anastasio) qui appartenait au complexe abbatial des Trois fontaines dont elle était l’église principale.
Jusqu’au 14ème siècle on la connaissait sous le nom de Saint Anastase de Trévi avant qu’elle ne soit qualifiée de
« paroisse pontificale », soit parce qu’elle est située à proximité du Quirinal, soit parce qu’elle conserve dans l’abside les cœurs et entrailles de plusieurs papes. Elle conserva ce titre jusqu’en 1876.
L’usage de prélever les viscères avant l’embaumement fut inauguré par Sixte Quint à sa mort en 1590 et se maintint jusqu’à
Léon XIII († 1903) avant que son successeur, Pie X, n’y mette un terme.
L’actuel édifice baroque fut construit par Martino Longhi le Jeune entre 1644 et 1650 à l’initiative du cardinal de Mazarin comme en témoigne son blason du chapeau au centre du triple fronton. Les urnes de marbre de vingt-trois pontifes sont conservées dans une pièce fermée au public.
A noter que le peintre Bartolomeo Pinelli (1781-1835) et la poétesse russe Zinaida Volkonskaya (1792-1862) y sont inhumés.
Articles liés
Furent inhumés en la basilique Saint-Pierre de Rome, antique et actuelle, ou les grottes vaticanes
►Adéodat Ier
►Adéodat II
►Adrien Ier
►Adrien II
►Adrien IV
►Agapet Ier
►Agathon
►Alexandre VII
►Alexandre VIII
►Anastase II
►Anastase III
►Benoît Ier
►Benoît II
►Benoît III
►Benoît IV
►Benoît VI
►Benoît VIII
►Benoît XIV
►Benoît XV
►Boniface II
►Boniface III
►Boniface IV
►Boniface V
►Boniface VI
►Boniface IX
►Célestin IV
►Clément X
►Clément XI
►Clément XIII
►Conon
►Constantin I
►Donus
►Etienne II (III)
►Etienne III (IV)
►Etienne IV (V)
►Etienne V (VI)
►Etienne VI (VII)
►Etienne VII (VIII)
►Etienne VIII (IX)
►Eugène Ier
►Eugène II
►Eugène III
►Félix III (IV)
►Formose
►Gélase Ier
►Grégoire Ier
►Grégoire II
►Grégoire III
►Grégoire IV
►Grégoire V
►Grégoire IX
►Grégoire XIII
►Grégoire XIV
►Grégoire XVI
►Honorius Ier
►Honorius IV
►Hormisdas
►Innocent VII
►Innocent VIII
►Innocent IX
►Innocent X
►Innocent XI
►Innocent XII
►Innocent XIII
►Jean Ier
►Jean II
►Jean III
►Jean IV
►Jean V
►Jean VI
►Jean VII
►Jean VIII
►Jean IX
►Jean XIV
►Jean XV (probablement)
►Jean XXIII
►Jean-Paul Ier
►Jean-Paul II
►Jules III
►Landon (probablement)
►Léon Ier
►Léon II
►Léon III
►Léon IV
►Léon V ou basilique Saint-Jean-de-Latran
►Léon VI
►Léon VII (peut-être)
►Léon VIII (peut-être)
►Léon IX
►Léon XI
►Léon XII
►Marcel II
►Marin Ier, alias Martin II
►Marin II, alias Martin III (selon la tradition)
►Nicolas Ier
►Nicolas III
►Nicolas V
►Paul Ier
►Paul II
►Paul VI
►Pelage Ier
►Pélage II
►Pie VI
►Pie VIII
►Pie X
►Pie XI
►Pie XII
►Sabinien
►Serge Ier
►Serge II
►Serge III
►Séverin
►Simplice
►Sisinnius
►Sixte IV
►Symmaque
►Théodore Ier
►Théodore II
►Urbain VI
►Vitalien
►Zacharie
Furent inhumés à Rome mais ailleurs qu'en la basilique Saint-Pierre
►Adrien VI
Basilique Saint-Pierre, puis église Santa Maria dell' Anima
►Agapet II
Basilique Saint-Jean-de-Latran
►Alexandre II
Basilique Saint-Jean-de-Latran
►Alexandre III
Basilique Saint-Jean-de-Latran
►Anastase Ier
Cimetière Pontien à Rome
►Anastase IV
Basilique Saint-Jean-de-Latran à Rome (Italie)
►Benoît VII
Basilique Sainte-Croix-de-Jérusalem
►Benoît XIII (second du nom)
Basilique Santa Maria sopra Minerva
►Boniface Ier
Cimetière Sainte-Félicité sur la via Salaria
►Caius ou Gaïus
Catacombe de Calixte sur la via Appia
►Calixte II
Basilique Saint-Jean-de-Latran
►Célestin Ier
Basilique Saint-Sylvestre au-dessus de la catacombe de Priscille, via Salaria
►Célestin II
Basilique Saint-Jean-de-Latran
►Célestin III
Basilique Saint-Jean-de-Latran
►Clément III
Basilique Saint-Jean-de-Latran
►Clément VII (second du nom)
Basilique Santa Maria sopra Minerva
►Clément IX
Basilique Saint-Pierre, puis basilique Sainte Marie Majeure
►Clément XII
Basilique Saint-Jean-de-Latran
►Clément XIV
Basilique des Saints-Apôtres
►Damase Ier
Un cimetière via Ardeatina
►Damase II
Basilique Saint-Laurent-hors-les Murs à Rome
►Denys
Catacombe de Calixte sur la via Appia à Rome
►Eugène IV
Eglise San Salvatore in Lauro à Rome
►Eusèbe
Catombe de Calixte sur la via Appia à Rome
►Eutychien
Catacombe de Calixte
►Félix Ier
Catacombe de Calixte sur la via Appia
►Félix II (III)
Basilique Saint-Paul-hors-les Murs via Ostiense
►Grégoire XV
Eglise Saint-Ignace-de-Loyola
►Hilaire
Basilique Saint-Laurent-hors-les Murs
►Honorius II
Oratoire Saint-André-à-Celio, puis basilique Saint-Jean-de-Latran
►Honorius III
Basilique Sainte Marie Majeure
►Innocent Ier
Cimetière Pontien
►Innocent II
Basilique Saint-Jean-de-Latran, puis basilique Sainte-Marie du Trastevere
►Innocent V
Basilique Saint-Jean-de-Latran
►Jean X
Basilique Saint-Jean-de-Latran
►Jean XI
Probablement basilique Saint-Jean-de-Latran
►Jean XII
Peut-être basilique Saint-Jean-de-Latran
►Jean XIII
Basilique Saint-Paul-hors-les Murs
►Jean XVII
Vraisemblablement basilique Saint-Jean-de-Latran
►Jean XVIII
Basilique Saint-Paul-hors-les Murs
►Jules Ier
Catacombe de Calepode à Rome
►Léon X
Basilique Santa Maria sopra Minerva
►Léon XIII
Basilique Saint-Jean-de-Latran
►Libère
Catacombe de Priscille
►Lin
►Lucius II
Basilique Saint-Jean-de-Latran
►Marc
Catacombe Balbine via Ardeatina
►Marcel Ier
Catacombe de Priscille
►Marcellin
Catacombe de Priscille
►Martin V
Basilique Saint-Jean-de-Latran
►Miltiade
Catacombe de Calixte
►Nicolas IV
Basilique Sainte-Marie-Majeure
►Pascal Ier
Basilique Santa Prassede
►Pascal II
Basilique Saint-Jean-de-Latran
►Paul IV
Basilique Santa Maria sopra Minerva
►Paul V
Basilique Sainte-Marie-Majeure
►Pie II
Oratoire Saint-André-à-Celio, puis église Sant' Andrea della Valle
►Pie III
Eglise Sant' Andrea della Valle
►Pie IV
Sainte-Marie-des-Anges-et-des-Martyrs
►Pie V
Basilique Saint-Pierre, puis basilique Sainte-Marie-Majeure
►Pie IX
Basilique Saint-Pierre, puis basilique Saint-Laurent-hors-les Murs
►Serge IV
Basilique Saint-Jean-de-Latran
►Silvestre II
Basilique Saint-Jean-de-Latran
►Sirice
Catacombe de Priscille
►Sixte II
Catacombe de Calixte
►Sixte III
Basilique Saint-Laurent-hors-les Murs
►Sixte Quint
Basilique Sainte-Marie-Majeure
►Urbain VII
Basilique Santa Maria sopra Minerva
►Vigile
Eglise Saint-Sylvestre sur la via Salaria
►Zosime
Catacombe de Calixte ou basilique Saint-Laurent-hors-les Murs
Furent inhumés en Italie mais ailleurs qu'à Rome
►Adrien V
Eglise Saint-François de Viterbe (Italie)
►Alexandre IV
Eglise Saint-Laurent de Viterbe (Italie)
►Alexandre V
Basilique San Francesco de Bologne (Italie)
►Benoît IX
Abbaye territoriale Sainte Marie de Grottaferrata à une vingtaine de kms au sud-est de Rome (Italie)
►Célestin V
Basilique Santa Maria di Collemaggio à l'Aquila
►Clément IV
Eglise Saint-François de Viterbe (Italie)
►Grégoire VII
Cathédrale de Salerne (Italie)
►Grégoire VIII
Cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption de Pise (Italie)
►Grégoire X
Cathédrale Saint Donatien d'Arezzo (Italie)
►Grégoire XII
Cathédrale de Recanati (Italie)
►Innocent IV
Cathédrale de Naples (l'antique cathédrale détruite en 1294) (Italie)
►Jean XXI
Cathédrale de Viterbe (Italie)
►Lucius III
Cathédrale Santa Maria Assunta de Vérone (Italie)
►Martin IV
Cathédrale San Lorenzo de Pérouse (Italie)
►Nicolas II
Cathédrale Santa Reparata de Florence (Italie)
►Silvère
Île de Palmaria (Italie)
►Victor II
Eglise Santa Maria Rotonda de Ravenne (Italie)
►Victor III
Abbaye du Montcasin (Italie)
►Urbain III
Cathédrale Saint-Georges de Ferrare (Italie)
►Urbain IV
Cathédrale Saint-Laurent de Pérouse (Italie)
Sources principales :
-Dictionnaire historique de la papauté -sous la direction de Philippe Levillain -Ed. Fayard (1994)
-A propos des sépultures papales jusqu'au début du VIIIe siècle -Antiquité tardive, 1, 1993, p. 234-237 [Compte rendu de M. Borgolte) par Jean-Charles Picard
Publications de l'École Française de Rome (1998) pp. 255-263
-Etude sur l'emplacement des tombes des papes du IIIe au Xe siècle par Jean-Charles Picard - Mélanges de l'école française de Rome (1969) pp. 725-782
-« Sous les pas des frères », les sépultures des papes et cardinaux chez les Mendiants au XIIIe siècle par Haude Morvan -Ecole française de Rome (2021)
-https://www.persee.fr/doc/efr_0223-5099_1998_ant_242_1_5740
-https://www.persee.fr/doc/mefr_0223-4874_1969_num_81_2_7588
-https://www.treccani.it/enciclopedia/sergio-ii_%28Enciclopedia-dei-Papi%29/
-https://www.treccani.it/enciclopedia/papa-paolo-ii_%28Dizionario-Biografico%29/
-https://www.treccani.it/enciclopedia/papa-celestino-ii_%28Dizionario-Biografico%29/
-https://www.treccani.it/enciclopedia/papa-bonifacio-ix_%28Dizionario-Biografico%29/
-https://www.treccani.it/enciclopedia/papa-stefano-vi_%28Dizionario-Biografico%29/
-https://www.treccani.it/enciclopedia/costantino_%28Enciclopedia-dei-Papi%29/
-https://www.treccani.it/enciclopedia/benedetto-vii_%28Enciclopedia-dei-Papi%29/
-https://www.treccani.it/enciclopedia/innocenzo-iv_%28Federiciana%29/

TOMBES SÉPULTURES DANS LES CIMETIÈRES ET AUTRES LIEUX
par Marie-Christine Pénin
| THEMES |
| DE A à Z |
Pour s'abonner à la Newsletter : CLIQUER sur "Contact" en précisant bien le sujet et votre adresse E.mail.
LIEUX D'INHUMATIONS
EN LIGNE
-Abbaye, couvent et séminaire St-Magloire (75) (disparus en partie)
(ancien cimetière révolutionnaire)
(ancien cimetière révolutionnaire)
-Cimetière St-Jean-en-Grève (75) (disparu)
(disparu)
Cimetière Ste-Catherine (75)
(disparu)
-Eglise St-Denis-de-la-Chartre (75) (disparue)
(disparue)
COPYRIGHT 2010 - 2024 - TOUS DROITS RÉSERVÉS - Ce site est propriétaire exclusif de sa structure, de son contenu textuel et des photos signées MCP. Sauf accord du propriétaire du site, toute reproduction, même partielle, à titre commercial est interdite. Les reproductions à titre privé sont soumises à l'autorisation du propriétaire du site. A défaut, le nom du site et de son auteur doivent obligatoirement être mentionnés. Tous les droits des auteurs des oeuvres protégées reproduites et communiquées sur ce site sont réservés.